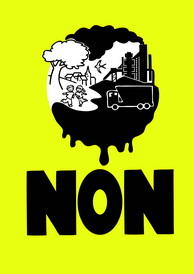Madame, Monsieur,
Je vous adresse la présente lettre dans le cadre de l’enquête publique relative au projet d’installation d’un parc photovoltaïque sur environ 9 hectares de terres agricoles situées à Sart-Bernard.
En tant que citoyen(ne) concerné(e) par les enjeux environnementaux, alimentaires et territoriaux de notre région, je tiens à exprimer mon opposition à ce projet pour les raisons suivantes :
1. Un projet qui se veut « pilote»
Un projet pilote est une mise en œuvre expérimentale et à petite échelle d'un projet, conçue pour tester la faisabilité et la viabilité d'une idée, d'un produit ou d'une méthode avant son déploiement à grande échelle.
Ce projet photovoltaïque se présente dans le dossier comme une initiative « pilote » dans la lutte contre l’érosion et la régénération des sols. Les végétaux qui seront semés entre et sous les panneaux vise à enrichir le sol et à lutter contre cette érosion. Toutefois, il est évident que la présence de panneaux photovoltaïques n'est pas essentielle pour obtenir ce résultat. En effet, une simple prairie de fauche, sans panneaux, aurait le même effet.
Par ailleurs, le dispositif de « bee monitoring » proposé, en plus de créer une compétition entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages déjà présentes sur le site, ne permettra pas de mesurer les avantages spécifiques de la nouvelle installation par rapport à une prairie de fauche.
Ainsi, ce projet ne peut en aucun cas être qualifié de « pilote ».
Le promoteur s’appuie sur la circulaire Borsus pour obtenir une dérogation en intégrant un volet dit "expérimental", en partenariat avec un centre de recherche. Mais cette collaboration ne repose sur aucun engagement durable : quelques mois de recherche peuvent suffire à justifier la dérogation, sans obligation de prolonger le partenariat ni de garantir une réelle plus-value scientifique sur le long terme.
2. Une artificialisation supplémentaire des terres agricoles
Le terrain visé est aujourd’hui une terre cultivable, classée comme telle dans le plan de secteur. Le projet envisagé impliquerait son détournement de sa vocation agricole au profit d’une exploitation énergétique à but lucratif. Il apparaît que le caractère d’exploitation industrielle est prédominant par rapport au caractère agricole.
Or, selon le Code du Développement Territorial (CoDT) et la circulaire du 14 Mars 2024, l’aménagement du territoire en Wallonie doit veiller à :
-
« une gestion parcimonieuse du sol »
-
« la préservation des ressources naturelles »
-
« le maintien d’un développement rural durable. »
-
« Éviter la concurrence d’usage des sols »
L’implantation d’un parc photovoltaïque industriel sur des terres arables va à l’encontre de ces principes fondamentaux, notamment en termes de soutenabilité à long terme et de résilience alimentaire des territoires.
3. 🌾 Un danger pour la souveraineté alimentaire wallonne
La Wallonie a déjà perdu 60 000 hectares de terres agricoles ces 30 dernières années au profit du bâti, des infrastructures et de l’industrie (source : Observatoire du foncier wallon).
Ce phénomène accentue :
-
la spéculation foncière,
-
la raréfaction des terres accessibles pour les jeunes agriculteurs et maraîchers,
-
et met en péril la souveraineté alimentaire régionale.
Dans son Plan stratégique wallon pour la PAC 2023-2027, le Gouvernement wallon affirme l’importance de protéger les terres agricoles et de maintenir leur fonction nourricière face aux pressions foncières.
4. ⚖️ Le cadre juridique européen soutient cette position
L’Union européenne reconnaît la nécessité de lutter contre l’artificialisation des sols et promeut la préservation des terres agricoles productives dans plusieurs documents stratégiques, notamment :
-
Le Green Deal européen (Pacte Vert pour l’Europe)
-
La Stratégie "De la ferme à la table" (Farm to Fork Strategy)
-
La nouvelle directive sol en cours d’adoption, qui vise à rendre juridiquement contraignante la protection des sols contre l’artificialisation.
5. 🔋 Des alternatives énergétiques existent, sans sacrifier les terres agricoles
Je ne suis pas opposé(e) à la transition énergétique, bien au contraire. Toutefois, elle doit s’opérer dans le respect du territoire, des ressources agricoles et du bon sens paysager.
La priorité d’installation des panneaux photovoltaïques doit être donnée à :
-
l’équipement des toitures (bâtiments publics, industriels, hangars agricoles),
-
la reconversion de friches industrielles,
-
ou la couverture de parkings existants, conformément à la stratégie wallonne de déploiement des énergies renouvelables.
6. 🏞️ Impact paysager et risques visuels
L’installation d’un parc photovoltaïque industriel, sur le plateau de Sart-Bernard, à l’entrée du Parc Naturel du Condroz, aura un impact paysager majeur sur une zone rurale de grande valeur.
Le caractère artificialisant sera perçu comme une nuisance visuelle et dénaturera un paysage sensible.
De plus le site pressenti se situe dans le périmètre de plusieurs points de vue remarquables. A savoir NAM-452, NAM-466, NAM-465 et NAM-448.
L’impact visuel sera important pour les riverains (pour les quartiers de Sart Bernard situés au Sud Est du terrain et également pour les habitants des communes de Wierde et de Naninne.
Pour les riverains situés au Sud Est, les risques d’éblouissement n’ont pas été évalués. Cette installation industrielle rompra la cohérence avec le caractère rural du hameau.
L’étude ne présente pas de photo montage sur différents points de vue en contradiction avec le Codt qui exige de vérifier la conformité d’un projet à son environnement immédiat.
L’argument de « faible impact paysager » est totalement fallacieux. Les aménagements périphériques n’atténueront que la visibilité à proximité du site. Or, ce versant est bien visible depuis plusieurs points de vue remarquables répertoriés dans cette zone.
D’autre part, l’implantation en un seul bloc compact renforce le caractère massif du projet, dont l’identification dans le territoire sera permanente. Cet aspect compact va altérer le caractère rural des lieux en réduisant la part des marqueurs paysagers qui déterminent cette spécificité locale du territoire.
Visuellement, la configuration du projet induira une perception d’augmentation de l’artificialisation du territoire. La proximité du projet avec la Zone d’Activités Economiques de Naninne (à 1 kilomètre au nord) induira immanquablement une perception d’étalement urbain, que ce soit des usagers de la N4, du chemin de fer ou des promeneurs sillonnant les alentours. À terme, le risque est réel d’attirer de nouveaux projets d’infrastructures de l’agriculture industrielle sur le kilomètre de « mauvaises » terres vers le nord. Ces parcelles subiront elle-même la pression de projets « de comblement » qui subsistera entre ce projet et le bord de la zone d’habitat (H01) de Naninne.
7. L’atténuation de l’impact paysager par les haies:
L'argument avancé selon lequel les haies envisagées suffiraient à réduire l'impact paysager du projet apparaît fragile et difficilement convaincant pour plusieurs raisons :
-
Caractère hypothétique de l'efficacité de la mesure
La haie est présentée comme une solution d'atténuation, mais son efficacité repose sur plusieurs hypothèses qui ne sont pas garanties :-
La haie mettra plusieurs années à atteindre une hauteur et une densité suffisantes, pendant lesquelles l'impact visuel du projet sera pleinement perceptible.
-
Il n'est pas assuré que la haie sera correctement entretenue sur le long terme. En l'absence de coupe régulière, d'arrosage et de remplacement des plants morts, elle pourrait ne jamais atteindre son objectif de réduction de l'impact paysager.
-
-
Fiabilité des photomontages
Le document de présentation reconnaît que les photomontages sont « à titre indicatif », ce qui implique que :-
La réalité perçue sur le terrain peut être très différente de ce qui est représenté, en fonction des saisons, des angles de vue et de la densité effective des plantations.
-
L'effet « masquant » des haies peut donc être surestimé, particulièrement dans les premières années, ce qui pourrait fausser l’évaluation de l'impact réel du projet.
-
-
Impact immédiat vs impact à long terme
Les photomontages ne tiennent pas compte de l'impact immédiat du projet sur le paysage :-
Un projet de grande envergure, tel que celui-ci, est visible dès sa construction, et les haies ne pourront pas atténuer cet impact à court terme.
-
Cela pose une question d'acceptabilité pour les riverains, qui devront supporter les effets visuels du projet pendant plusieurs années avant que les haies ne parviennent à remplir leur rôle d'atténuation.
-
-
Limites de l'intégration paysagère et écologique des haies
Une haie, même bien conçue, ne suffit pas à garantir une intégration paysagère et écologique efficace :-
Si elle est trop artificielle, mono-spécifique ou mal positionnée, elle pourrait accentuer la coupure visuelle en mettant en évidence les contours du projet plutôt que de les atténuer.
-
L'absence d'un plan de gestion précis, intégrant des espèces locales, variées et adaptées au sol, compromet également la valeur écologique de ces plantations.
-
Contrairement à ce qu'affirme le promoteur, le parc photovoltaïque, en raison de son envergure, aura un impact paysager considérable. La plantation de haies ne peut être considérée comme une solution suffisante ou fiable pour réduire cet impact. En l'absence de garanties quant à la rapidité des résultats, à un entretien adéquat et à une véritable cohérence avec le paysage existant, cette mesure semble davantage relever du symbolique que d'une stratégie réelle d'intégration paysagère et écologique.
8. 🗣️ Un manque de participation citoyenne en contradiction avec les exigences réglementaires
La circulaire wallonne du 14 mars 2024 relative aux projets d’installations photovoltaïques sur terres agricoles rappelle expressément la nécessité d’associer les populations riveraines dès le lancement du projet, afin de garantir une information transparente, un dialogue équitable et l’adhésion démocratique aux projets impactant leur cadre de vie.
Or, à Sart-Bernard, ce principe fondamental n’a pas été respecté. La population locale n’a pas été consultée en amont du dépôt de la demande, ni intégrée à une démarche de co-construction. Cette omission va à l’encontre non seulement des bonnes pratiques recommandées, mais aussi des exigences politiques de concertation territoriale en matière de transition énergétique.
Fondement jurique : Convention d’Aarhus (1998), transposée dans le Code de l’Environnement (Livre Ier, art. D.29-1 à D.29-15) → droit du public à une information et une participation effectives.
📢 En conclusion
Ce projet, bien que présenté comme “pilote”, constituerait un précédent dangereux pour l’avenir de l’agriculture en Wallonie. Il contribue à une tendance préoccupante de transformation irréversible de terres agricoles en zones industrielles, au mépris des orientations juridiques, environnementales et sociales portées à tous les niveaux de pouvoir.
Ce projet porte une atteinte grave au paysage et au patrimoine visuel du village, à l’entrée du Parc Naturel du Condroz.
Je vous invite donc à refuser ce projet, ou à tout le moins à en réévaluer la localisation, en cohérence avec les objectifs de durabilité, de justice territoriale, de participation citoyenne et de préservation du patrimoine rural.
Je vous remercie de prendre en considération ma position dans le cadre de cette enquête publique.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.